Compte rendu de Féminismes et féminités par Patrick de Neuter
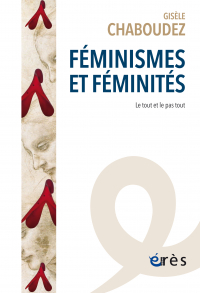
Gisèle Chaboudez, Féminismes et féminités :Le tout et le pas tout
Toulouse, Érès, coll. « Figures de la psychanalyse », 2022, 150 p.
Par Patrick De Neuter, pr. émérite psychopathologie. Psychothérapeute (individuel et de couple), psychanalyste, superviseur patrick.deneuter@outlook.be
Dans son nouveau livre, Gisèle Chaboudez poursuit son travail de rendre plus lisible l’enseignement de Lacan, de mettre en évidence ce qui en reste oublié et ce qui peut aider à aborder judicieusement les cliniques actuelles. L’autrice a l’art de nous rendre sensibles à l’évolution de l’enseignement de Lacan. L’art aussi de repérer quelques phrases énigmatiques et méconnues de ses lecteurs et pourtant particulièrement précieuses pour aborder le monde et la clinique d’aujourd’hui. Lacan ne les commentant pas lui-même, elles nécessitent donc commentaires et interprétations. Ainsi par exemple son affirmation lapidaire : « Il n’y a pas de rapport sexuel » qui veut dire, entre autres, que les logiques sousjacentes et les modes de jouissance étant si différents, les rapports sexuels ne peuvent être que partiellement satisfaisants, voire même impossibles. L’autrice aborde aussi cet autre aphorisme « La femme n’existe pas », source de nombreux malentendus alors qu’il veut dire, entre autres, qu’il n’y a pas d’essence du féminin, que les femmes ne se prêtent pas à la généralisation, ce que Freud disait déjà en 1931 dans son livre sur la sexualité féminine. C’est aussi ce que Gisèle Chaboudez avait développé dans son livre précédent Féminité singulière. La question reste pour moi de comprendre pourquoi pour Lacan l’homme semble exister et peut être défini ?
Dans ce nouveau livre, G. Chaboudez aborde et se centre à la fois sur l’apport de Lacan quant au féminin et sur ce qu’apportent certaines féministes à la psychanalyse mais aussi les critiques en partie injustifiées qu’elles ont formulées à l’égard de l’enseignement de Lacan et ce que l’on peut leur répondre. Elle consacre la première partie de son ouvrage à l’explicitation des deux logiques et les deux jouissances : toute-phallique et pas-toute-phallique, proposées par Lacan. Elle insiste sur le fait que les secondes, auxquelles les femmes ont davantage accès, ne sont ni opposées ni complémentaires à la logique et à la jouissance toute-phallique que privilégient de nombreux hommes, logique et jouissance qui s’incarnèrent depuis des siècles dans le machisme et le patriarcat. Ni opposées ni complémentaires, ses logiques et les jouissances pastoutes-phalliques sont supplémentaires aux premières. Aujourd’hui certains hommes sont aussi accessibles à ces deux types de logique et ces deux types de jouissances.
Gisèle Chaboudez a déjà illustré ceci dans son livre précédent par la vie de Thérèse d’Avila qui tantôt vivait ses extases divines pas-toute-phallique et tantôt se consacrait très phalliquement à l’organisation de son couvent.
Cette qualification des logiques et jouissances comme phalliques et pas-toutes-phalliques nécessite évidemment de préciser ce que Lacan entend par Phallus. Elle souligne que Lacan insiste à plus d’une reprise que le phallus n’appartient ni à l’homme ni à la femme. Qu’il est « signifiant du sujet, de la parole, du désir, de la jouissance dans les deux sexes » (p. 46). Elle met aussi en évidence que pour Lacan le phallus est bi-sexuel (p. 46) tout comme Freud affirma déjà en 1932 que la libido n’était ni masculine ni féminine mais qu’elle était au service des deux sexes. C’est pourquoi Gisèle Chaboudez peut écrire « qu’une part du féminin est phallique sans être pour autant masculine ». Ce qui va à l’encontre des significations courantes du concept de phallus, héritage de notre passé grec et romain puis chrétien, autrement dit du patriarcat encore bien vivant aujourd’hui.
Dans la suite de ce livre, l’autrice aborde non seulement ce que la psychanalyse a pu dire à propos des féminismes mais aussi ce que certaines féministes peuvent apporter à la psychanalyse. Elle insiste : « les psychanalystes ne peuvent plus parler du féminin sans tenir compte de ce que ces discours féministes nous apprennent », d’où ces pages consacrées à Simone de Beauvoir, Karen Horney, à Butler, K. Mill et M. Wittig.
Ces discussions avec les féministes permettent à Gisèle Chaboudez d’évoquer L’Amant de Lady Chatterley dans lequel l’auteur, D.H. Lawrence, décrit magnifiquement l’évolution d’un couple qui en arrive à trouver non sans difficulté une façon de jouir l’un avec l’autre plutôt que l’un de l’autre.
Cette même fiction, où il est question de jouissance clitoridienne, permet à notre collègue de reconnaître que la psychanalyse « a fait défaut à étudier les données de la sexologie », « sauf Lacan, à bas bruit », écrit-elle. Notamment lorsqu’il accorde une grande importance à la détumescence de l’organe mâle lors de l’orgasme, détumescence qui met fin au rapport sexuel pour les deux amants. Ce phénomène physiologique amène Lacan à souligner que la castration est plutôt du côté de l’homme que du côté de la femme. La castration, dit-il, est principalement incarnée dans la détumescence masculine ! On est loin de la conception d’une castration œdipienne apportée par le père.
Elle envisage aussi des positions féministes plus radicales comme celle de K. Millet de laquelle elle regrette l’ignorance des avancées de Lacan qui, refusant l’assimilation du féminin à la passivité, souligne au contraire que ce sont « les femmes qui ont les hommes ». Ce que Chaboudez commente ainsi : « Dans le couple c’est souvent leur désir qui fonde et soutient la relation de leur couple sexuel. » On est loin de l’association freudienne du féminin à la passivité, association que Freud lui-même considérait d’ailleurs comme fréquente mais tout à fait insatisfaisante. Ce que l’on oublie souvent.
À propos des femmes, elle rappelle que Lacan a affirmé que c’était grâce à leur position pas-toute-phallique que les femmes pouvaient « tresser dans l’amour » un rapport sexuel effectif de deux jouissances et non d’une seule (côté masculin) et son objet (côté féminin) (p. 130). Énoncé d’un couple sexuel possible dont elle a trouvé la confirmation dans des écrits de la féministe Bell Hooks. Gisèle Chaboudez reprend cette thèse avec insistance, ici et dans plusieurs ouvrages précédents.
Elle rappelle ensuite l’interprétation par Lacan du mythe féministe de la création d’Ève, comme donnant à penser que c’est Ève qui a « inventé le langage ». C’est elle qui parle au serpent et c’est elle qui aurait parlé pour établir un autre rapport que sexuel pour compenser l’absence de rapports sexuels totalement comblants (p. 105).
Avec le « phallus lesbien » de Butler, G. Chaboudez aborde la dommageable fixation de Butler aux premières conceptions lacaniennes du Phallus et du Nom-du-Père. Elle rappelle que Lacan a fortement évolué dans son élaboration des concepts de phallus et de Nom-du-Père qu’il finit par « laisser tomber à perpétuité ».
Le vœu de Chaboudez est que les psychanalystes s’aperçoivent que la psychanalyse, notamment lacanienne, contient en germe, porte en son sein, le socle du renouvellement massif qu’elle pense manifestement indispensable. Elle souhaite qu’ils s’en aperçoivent et qu’ils s’engagent dans ce renouvellement.
S’inscrivant de plain-pied dans les recherches actuelles sur le féminin et sur les féminismes, ce livre intéressera non seulement celles et ceux qui s’intéressent à ce que Lacan a pu en dire mais aussi toutes celles et ceux qui sont concernés par cette thématique tout actuelle. Ils y trouveront, dans un style aussi élégant que lisible, non seulement l’évolution de Lacan mais aussi ce qui de son enseignement a été méconnu, voire occulté, concernant la complexité des relations entre les hommes et les femmes aujourd’hui.
En conclusion, Gisèle Chaboudez nous propose un livre original, d’une érudition remarquable, nourri par une importante clinique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte, et qui laisse néanmoins la place aux questionnements et aux débats.
